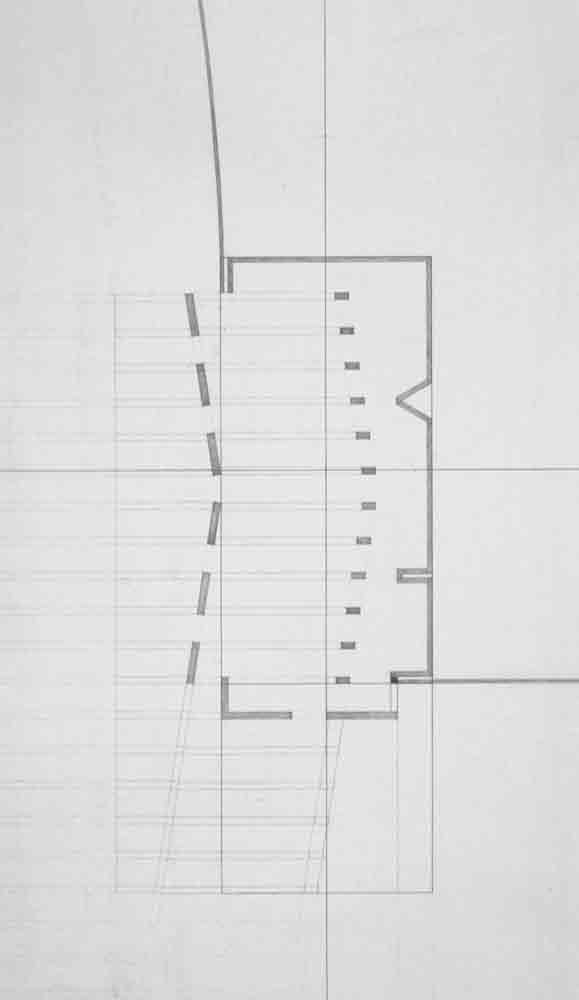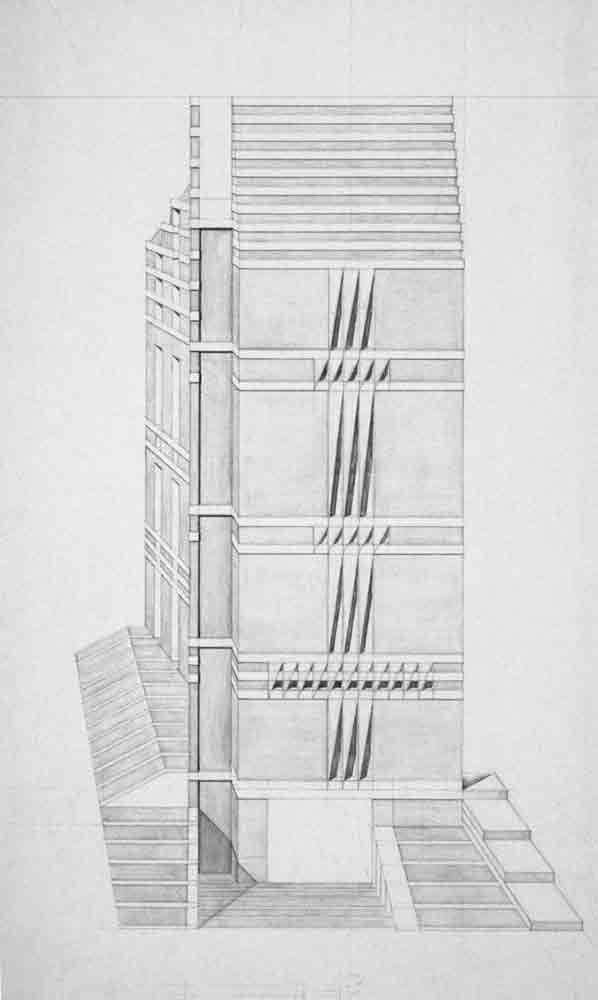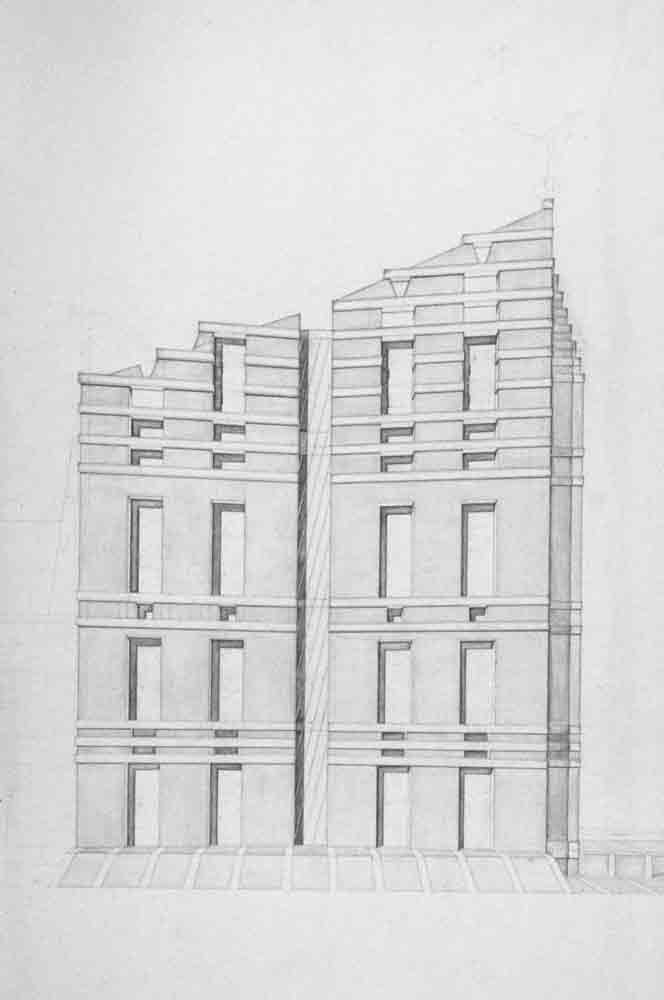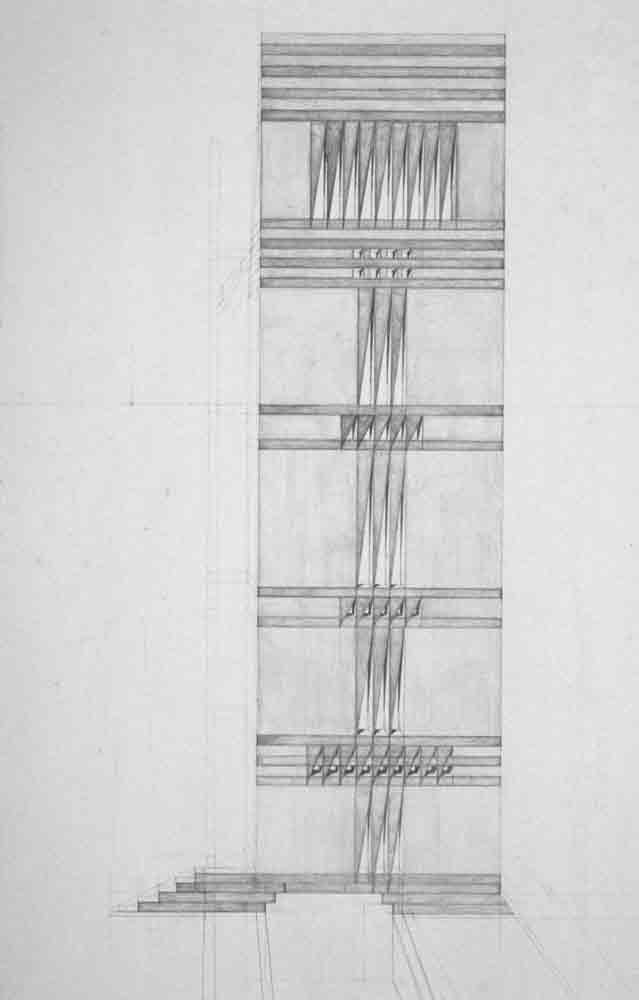1992 Audergem
Un édifice sur un coin de deux rues…..
Très peu d’éléments ou d’instruments de l’architecture.
On voit immédiatement une disposition simple et claire.
Que voit-on ?
En plan :
Un coin…. droit
indiquant deux directions.
Un rythme tant intérieur qu’extérieur,
semblant venir d’un infini extérieur,
se finissant et s’établissant matériellement
dans le vide du coin .
On pourrait penser l’inverse.
Ce serait même mieux.
Que de quelques points matériels orientés
-ce sont des rectangles-
disposés dans le vide de ce coin qui devient un fond
et y établissant une distance ou une mesure simple,
s’étirent des lignes vers l’infini
face à un fond du coin.
Ces points ne sont pas à même distance du fond .
Leurs alignements instituent un pli.
C’est-à-dire une double oblicité.
Puis,
à une distance nette de l’alignement de ces points,
2 fois 3 traits alignés comme ces points.
Entre ces points et ces traits
il ne semble pas y avoir un vide pur.
Il semble y avoir un vide muni d’une loi :
la loi de la même distance
entre ces points et ces traits.
Un vide muni d’une loi est un espace.
Et on note que cet espace
entre ces points et ces traits
est le seul espace de ce projet.
Espace virtuellement infini
mais commençant dans le vide de ce coin.
Cet édifice se fait donc d’un commencement.
Et y demeure.
Et c’est un commencement
connoté d’un infini.
On note que cet espace
s’établit dans ce coin
mais semble en même temps le quitter…
Tout cela par la double oblicité.
On sait que l’oblique
ne va pas vers soi-même.
Elle va vers de l’autre.
L’autre ici est l’infini…
Dont ce projet est un fond.
Fond que
du petit côté de l’édifice
la face en forme de niche
retient
pour ce qui en est physique
.
On note bien donc
qu’il y a du fini
qui fait part d’un infini
et qu’ils ne sont donc pas en opposition
On note bien
qu’il y a un intérieur
et
qu’il y a un extérieur
mais ils ne sont pas en opposition
On note bien
que cet édifice a des faces
mais celles-ci n’enserrent
pas la profondeur de l’édifice.
On voit bien que les faces
ne s’accolent pas à l’édifice
pour le refermer sur soi.
On voit donc bien que
les faces et la profondeur de l’édifice
ne sont pas en opposition.
La structure de cet édifice
est donc bien en
non-opposition entre fini et infini,
non-opposition entre intérieur et extérieur,
non opposition entre face et profondeur.
Cette triple non-opposition
est celle aussi de l’organisation mentale
de l’anthrope-sujet.
(Qui n’est pas ‘l’être humain’ humaniste
du vieux monde idéaliste
de la Renaissance et post-renaissant
qui sévit encore aujourd’hui)
C’est pour cet anthrope-sujet
que la structure spatiale de cet édifice
est pertinente.
*
On remarque la même chose en élévation.
On note immédiatement que
l’élévation de cet édifice
est très construite.
et qu’elle va vers un infini.
Ne pouvant y arriver
les deux faces (image 3)
sont taillées d’un geste oblique.
Elle ne s’arrêtent pas là.
Virtuellement elles vont à l’infini.
Elles sont donc in-finies aussi.
Et laissent derrière elles
le ciel infini dans l’édifice.
Là aussi donc, en élévation,
on note la triple non opposition
entre fini et infini,
entre intérieur et extérieur,
entre face et profondeur.
*
Cette triple non opposition
est celle de l’organisation mentale
d’un sujet non individualiste
non central à lui-même
qui n’existe pas a priori
et est le croisement des autres.
Sujet qui vit donc en
non-opposition entre fini et infini,
non-opposition entre intérieur et extérieur,
non opposition entre face et profondeur.
Ce sujet…
On ne peut le mettre dans un petit monde fermé.
Son monde est in-fini infini.
Comme cette architecture
de son commencement.
Voilà tout ce qu’il y a à dire
essentiellement
sur l’architecture de cet édifice.